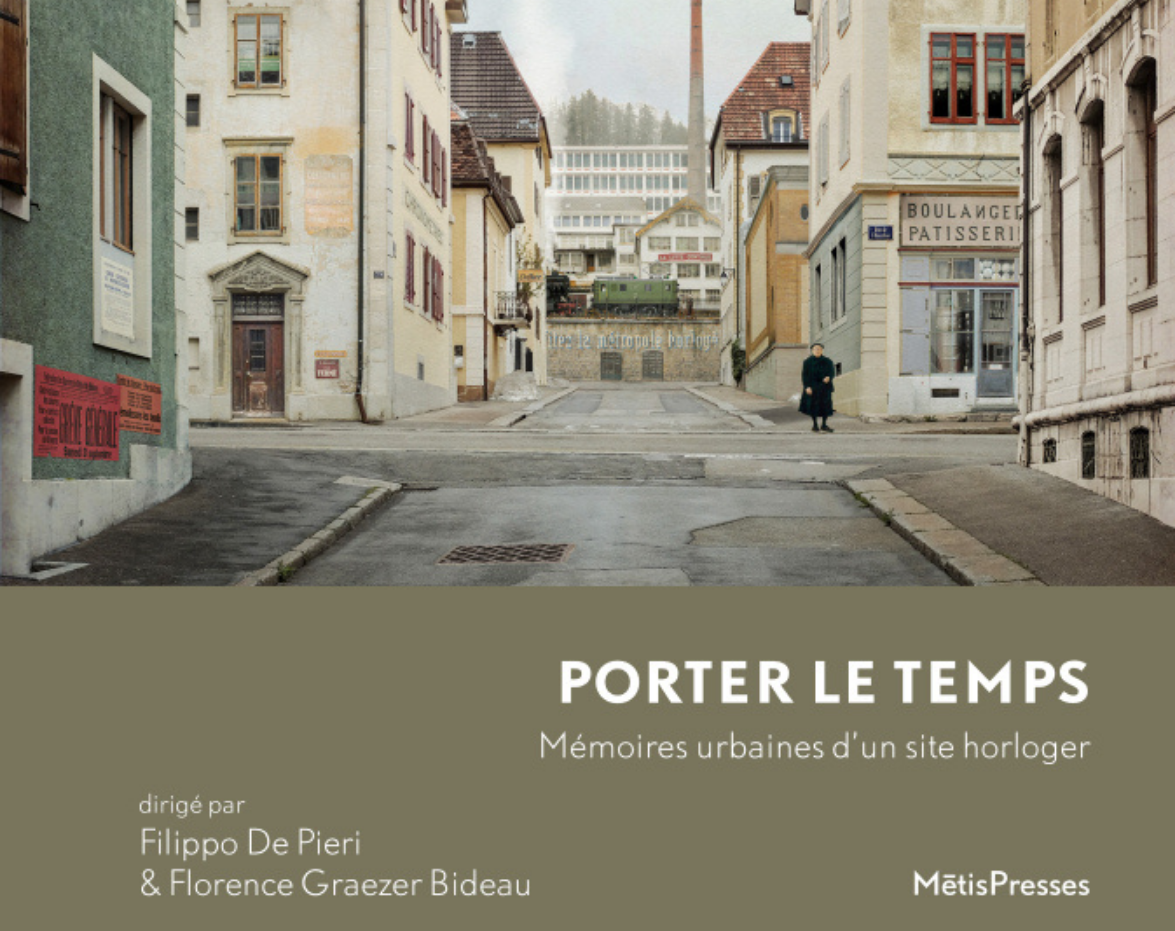art
Meet Tiago Rodrigues and Yves Daccord

Dans la violence, et en particulier dans la guerre, on est happé, aspiré irrésistiblement, par l’intensité de ce que l’on perçoit, de ce qui se donne à voir.
Tout est plus intense, plus fort, plus âpre, plus coloré aussi, que les images qui se déclinent dans la vie quotidienne, ce que l’on peut appeler, la vie en temps de paix, à l’abri de la violence. Et cela, que l’on soit acteur ou simple observateur.
C’est la peur qui souvent s’invite la première, et absorbe l’être entier.
La peur de l’inéluctable. Son goût acide, la respiration courte, et l’impuissance qui envahit la moindre parcelle de conscience de celui ou celle qui la ressent.
La peur de ceux ou celles qui ont compris qu’ils seront les prochains, qu’ils n’y échapperont pas, que le pire est là.
Et en écho surgit l’angoisse face à ce spectacle. Angoisse de ne rien pouvoir faire, de ne pas savoir par où commencer. Comment contrer l’irrémédiable ? Impuissance brute, fatale. Du côté de celui qui regarde.
Il y a des images, entrevues un instant, au détour d’un écran ou d’une page de journal, qui marquent à jamais, et qui hantent comme autant de présences fantomatiques qui nous entourent d’un peu loin.
Trois femmes ukrainiennes, la quarantaine, armées chacune d’une kalachnikov, qui disent dans le silence de leur regard leur détermination de résister.
Ces enfants, ces femmes, ces hommes âgés, entassés ensemble dans ce qui s’apparente à un campement souterrain, au fond du métro de Kiev.
Cet homme, en larmes, sur un quai de gare, adossé contre une vitre de train, derrière laquelle se trouvent sa mère et sa femme, avec leur nouveau-né. Sa famille fuit l’Ukraine, lui reste, pour se battre et défendre son pays. Sur leurs visages, à nouveau la peur, l’impuissance, puis demain la souffrance. Sans doute.
Ces étudiants africains, indiens, pris au piège en Ukraine.
Ces russes qui voient leur pays couper les ponts avec l’Europe, leur Europe.
Hier, les blessés massacrés dans un abri de fortune à Alep.
Hier encore, les soignantes et soignants à travers un pays, la Syrie, où les lieux de santé sont devenus un champ de bataille constant.
Les réfugiés afghans qui s’échouent aux frontières de l’Europe.
Partout, surgit la souffrance. Ses bruits, ses odeurs. Rances, implacables.
Tous ces prisonniers, conscients de leur extrême vulnérabilité, dont le silence accompagne à jamais, en laissant deviner l’inimaginable. Ce silence, blême, quand il n’y a plus de mots.
Cet enfant blessé, dont la jambe déchiquetée commence déjà à pourrir alors que ses parents supplient de lui venir en aide.
Ces familles qui attendent des nouvelles de leurs fils disparus, il y a une heure, ou il y a dix ans, avec toujours, la même intensité du désespoir.
Il n’y a rien à faire, juste à accompagner et se laisser avaler.
La force, l’intensité du sentiment d’aspiration saisissant quiconque qui assiste à cela, sont telles qu’elles laissent peu de place à l’invisible, l’implicite, l’indicible.
Cela semble retirer toute possibilité de s’arrêter, de ressentir réellement et de penser plus loin.
C’est pourtant auprès de ce qui est hors du moment présent, hors du champ de ce qui est donné à voir et à percevoir qu’il faut aller chercher. C’est là, hors-champ, invisible, que se construisent – ou se déconstruisent les liens tissés au fil des ans, les règles communes implicites, les histoires et mémoires collectives, les rêves et les cauchemars qui accompagnent les êtres humains de génération en génération.
Et c’est justement dans cet hors-champ que Tiago Rodrigues plante son théâtre. Il le parcourt, le laboure parfois, l’appréhende toujours, laissant monter au fil des actes, au fil des répliques, les liens communs, les liens intimes. Émerge alors sous nos yeux ce qui nous constitue comme communauté et cela d’autant plus facilement que les pièces que Tiago nous propose se nourrissent de la violence. La violence de la guerre dont les humanitaires cherchent à atténuer les effets. La violence de l’autoritarisme, du fascisme, que la culture cherche à contrer.
Les questions peuvent dès lors surgir et se déployer dans cet espace désormais habité : qu’est-ce qui fait tenir ensemble une communauté ? Comment vivre ensemble ? De qui est constitué nos « nous » ?
Autant d’interrogations que la violence, quand il est donné de l’appréhender « hors-champ », met à nu. Ce questionnement ne peut être abandonné à ceux qui définissent à longueur d’injures, de saillies, de contre-vérités ou d’algorithmes biaisés, l’« autre », l’« ennemi » et de par ce fait un « nous » prétendument pur.
Le théâtre joue ainsi un rôle vital lorsqu’il permet d’appréhender ces questions, de les laisser résonner dans un individuel qui peut se nourrir du collectif. Saisir et comprendre dès lors l’impact de la violence et de la guerre sur nos dynamiques sociales s’avère de plus en plus essentiel.
Pour nourrir nos choix, les étayer, les cristalliser et se souvenir qu’il n’est pas trop tard pour décider entre polarisation et convergences, entre les différentes définitions de ce ou ces « nous ».